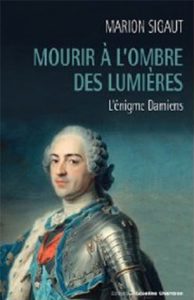Série – Comment Internet a permis de contourner la censure – Dernier épisode : votre haine vous aveugle
Des éditeurs, des correcteurs et de la presse dont, jusqu’à Internet, on ne pouvait se passer pour atteindre ses lecteurs.
Souvent je lis ou j’entends, ici où là, que j’ai rejoint E&R et Alain Soral parce que je désespérais de trouver un éditeur.
C’est une contrevérité.
J’ai trouvé mon premier éditeur en 1989, et je n’ai cessé depuis d’enchaîner contrat sur contrat avec des maisons d’éditions. Citons Sylvie Messinger, Flammarion, Denoël, L’Harmattan, l’Atelier, Jacqueline Chambon, Éditions de Bourgogne et Actes-Sud avant Kontre Kulture, puis enfin Civitas et Sigest depuis.
Me présenter comme ayant eu du mal à me faire éditer c’est vraiment n’avoir rien compris à mon parcours et à la nature de mes difficultés.
Peu de temps après avoir rejoint E&R, j’ai proposé une série d’articles destinés à raconter ce que fut ma longue traversée du désert.
Les revoici.
7e et dernière partie : « Votre haine vous aveugle »
Chat échaudé craint l’eau froide. J’aurais été complètement idiote, quand je me relançai dans l’aventure éditoriale dix ans plus tard, de ne pas me méfier.
J’avais totalement changé mon fusil d’épaule. Apaisée et heureuse, j’avais repris mes études et rapatrié mon centre d’intérêt vers mon pays pour finalement chercher un éditeur susceptible de publier de l’Histoire.
Une fois encore, j’étais inclassable. Certes, c’était de l’Histoire, de la vraie, de l’Histoire de France, bien de chez nous. Titulaire d’un DEA, je connaissais désormais le métier, auquel je pouvais apporter ma facilité de plume. Mais je n’étais ni universitaire (vous enseignez où ?) ni susceptible de présenter une bibliographie personnelle attestant d’une quelconque reconnaissance sociale.
Il me fallut tout reprendre à zéro et partir à la recherche d’un éditeur comme si j’étais débutante.
Il en fut cette fois-là comme des précédentes : c’est mon texte qui parla pour moi. Un gros tapuscrit de 600 pages posé sur la table d’une dame suscita un intérêt immédiat : « Vous pouvez passer ? »
J’alertai d’emblée mon éditrice sur les difficultés que j’avais rencontrées dans le monde des médias, et lui suggérai même d’utiliser un pseudonyme. Ce que je voulais, c’était toucher le public, avec mon nom ou avec un autre.
Non. Elle me rassura. Inutile. De l’eau a passé sous les ponts, ne vous inquiétez pas. Ça ira.
Tu parles !
Il en fut avec elle comme avec ceux qui l’avaient précédée : c’est mon originalité qui l’avait séduite. En abordant les réseaux de trafic d’enfants sous l’Ancien régime, j’apportais une lecture différente et iconoclaste de ce que nos manuels scolaires nous avaient enseigné. De plus, ma découverte de la face cachée les Lumières et de ce que valait l’anticléricalisme de bon ton de la société française avait tout ce qu’il fallait pour susciter son intérêt. Alors comme ça les crimes de l’Eglise ne seraient pas ce qu’on en a dit ? Et les violeurs d’enfants ne seraient pas ceux qu’on croit ? Intéressant, intéressant.
Le résultat de ma recherche était si touffu, si dense, que de mon manuscrit original elle décida de faire deux livres. Il y aurait « La Marche rouge » pour parler des enlèvements d’enfants, et « Mourir à l’ombre des Lumières » pour raconter la tragédie de Damiens, dont la découverte avait été à l’origine de ma recherche.
Le premier serait un essai et du second elle me demanda de faire un roman. Je n’en avais jamais fait. A partir de la trame originale, je lui en fournis un en trois mois de temps. A réception elle m’appela pour me demander si je pouvais y apporter une correction.
« Une » ? Oui, une. Elle voulait savoir si je pouvais placer au début d’un chapitre les deux phrase que j’avais placées à la fin dudit. C’est tout. Pour le reste, je n’avais même pas besoin d’un correcteur.
J’étais devenue une vraie professionnelle. La reconnaissance allait venir.
N’est-ce pas ?
Allez, je vais faire court, on aura compris : il n’y eut pas une ligne, pas une ligne sur mon travail dans toute la presse. Pas un plateau télé, pas une interview radio, pas la moindre recension, nulle part, NULLE PART de ce qui était un travail original, bien fait, professionnel, et sur un sujet censé passionner le public. Je résolvais une énigme historique (pourquoi un inconnu que tout le monde prétendait fou avait-il attaqué le roi de France ?) et présentais le siècle des Lumières sous un jour nouveau à l’aide d’un texte accessible à tous, et personne n’en faisait mention.
Il y eut, à mes yeux, plus grave encore que la totale absence des médias. Je ne fus invitée à aucun salon du livre, alors que l’écriture historique fait l’objet d’un intérêt soutenu dans la société française et que différentes villes y consacrent des manifestations très courues où j’aurais pu à la fois trouver mon public et rencontrer mes pairs.
Maudite !
Et puis, un jour, il y eut un miracle.
Un libraire (ces gens-là ne fréquentent apparemment pas le gotha médiatique) arriva sur un plateau télé en brandissant « La Marche rouge » dont il fit un éloge tel que les ventes démarrèrent d’un seul coup. Emue et reconnaissante je lui envoyai un courrier de remerciements dans lequel je lui fis savoir qu’il n’avait pas été le premier mais le seul à en parler, il en remit une louche : « J’apprends que je suis le seul à avoir mentionné ce travail remarquable » et les ventes reprirent de plus belle.
Comme quoi !
La presse, c’est bien connu, vole au secours du succès. Dès qu’un auteur émerge, les journalistes s’emparent de ce qu’ils n’ont ni décelé ni provoqué et se mettent à parler d’un auteur jusque-là méconnu.
Sauf quand il s’agit de moi. Malgré un démarrage des ventes qui se confirma sur plusieurs semaines, aucun journaliste, aucun chroniqueur, aucun animateur de quelque média que ce soit ne mentionna mon travail. C’est comme ça, et pas autrement.
Un jour, un autre miracle se produisit. Oh ! Un bien petit miracle, mais un miracle quand même. Hérodote, la publication d’Histoire, publia un article élogieux, suivi par Historia. Le rédacteur en chef de la revue m’avoua, gentiment, que c’est sa femme qui, tombée par hasard sur l’exemplaire que je lui avais envoyé, lui a dit que c’était très bon. En homme avisé il écouta son épouse et je l’en remercie. Mais la gent journalistique ne releva pas.
J’avais été tellement étonnée de découvrir à quel point les Lumières avaient menti sur les crimes imputés à l’Eglise que je décidai, pour en avoir le cœur net, de partir en chasse d’informations qui m’auraient échappé au cours de mes recherches.
Car quoi, si on faisait de cette institution vieille de vingt siècles une organisation criminelle, ce ne pouvait être totalement faux tout de même.
Et, tandis que mon travail retournait à l’anonymat auquel on m’avait vouée, je décidai d’approfondir mes connaissances.
Le premier à qui je m’adressai était membre de l’organisation trotskiste que j’avais quittée avec pertes et fracas. Cela n’oblige pas à se faire la gueule, et j’envoyai un courrier amical à un vieux militant à qui je dis les choses tout net : je travaille sur l’anticléricalisme et la laïcité, je t’ai entendu évoquer la longue liste des crimes de l’Eglise, pourrais-tu éclairer ma lanterne ?
– Tu te fous de moi ?
Allons bon ! Je repris ma plume et lui assurai que j’étais sérieuse, que je désirais faire une recherche et que je voulais vraiment qu’il me donne des informations précises sur ce qu’il considérait comme des crimes commis par l’Eglise. Pour être plus précise, je lui indiquai que pour avoir bien étudié le siècle des Lumières, je savais par exemple que la mort du chevalier de la Barre n’était en rien imputable à l’Eglise, et qu’il fallait me donner des exemples plus probants.
– Mais enfin tu sais bien tout de même…
Je ne reçus aucune autre réponse.
Ma boîte aux lettres électronique étant destinataire de courriers émanant de la Libre Pensée, je décidai de m’adresser à ces vieux briscards de la cause anticléricale. Eux au moins, ils devaient savoir.
Partant d’une information par eux relayée concernant le malheureux chevalier de la Barre, j’apportai mon grain de sel historique pour préciser que, dans ce cas-là tout particulièrement, l’Eglise avait les mains propres puisque le jeune homme avait été mis à mort par des anticléricaux et dans le but, justement, de nuire à l’Eglise.
Après avoir fourni des arguments chiffrés, datés et sourcés, et répondu à leurs objections concernant le réel pouvoir de l’Eglise de France à l’époque considérée, je dus faire le constat, inquiétant tout de même, qu’ils parlaient désormais d’autre chose et je restai comme deux ronds de flan avec mon interrogation : quels sont les crimes imputables à l’Eglise qui résistent à l’analyse historique ?
Mon attention fut attirée un jour par le discours à la fois laïc et sincèrement patriotique d’une feuille de chou électronique qui tombait dans ma boîte aux lettres. La laïcité, c’est ma tasse de thé. J’ai toujours vécu dans cette idée qu’on ne mélange pas les affaires du bon Dieu avec celles de la République. Même quand il m’envoyait au catéchisme quand j’étais gosse, mon père me serinait que l’éducation devait être laïque, identique pour tous, et que là était la source de la paix sociale.
Comme mes études d’Histoire m’avaient fait découvrir la face méconnue des anticléricaux, j’entrai en communication avec l’éditeur de la feuille de chou, avec lequel j’amorçai un échange amical. Sa défense du peuple français contre la culpabilisation des bobos me semblait de bon aloi, et j’entrepris d’attirer son attention sur ce que j’avais découvert et me semblait susceptible de faire avancer le débat : si les crimes de l’Eglise n’étaient pas ce qu’on en a dit, on pouvait revoir les choses et les faire avancer.
Y a-t-il plus enthousiasmant que d’apporter sa pierre à l’édifice d’une plus grande intelligence du monde qui nous entoure ?
Je lui envoyai un jour un courrier dans lequel je lui indiquais que le soulèvement du peuple français pendant la Révolution s’était fait contre l’idéologie des Lumières et non avec. On n’avance pas de telles affirmations sans des arguments, j’en avais plein ma besace, accumulés au cours de mes recherches.
On est comme ça, nous les filles, quand on sait un truc, on se précipite pour le partager, j’étais contente de le faire avec un type apparemment sincère. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que, au lieu de me répondre sur ce que je lui avançais, il avait transféré mon message à une de ses collaboratrices qu’il chargea de le faire.
– Excusez-moi madame, ne le prenez pas mal, vraiment, mais j’ai failli mourir de rire en recevant votre message…
Qu’est-ce que c’était que cette conne ?
J’avais trois attitudes possibles :
– Comprendre que j’avais affaire à des cons et en rester là.
– Prendre ma plus belle plume pour les engueuler : ce n’est pas comme ça qu’on traite des gens qui veulent sincèrement discuter.
– Ignorer l’insulte et continuer d’argumenter.
Je fis le troisième choix, on ne se refait pas. Et j’envoyai à la dame, qui de toute évidence avait de la Révolution et des Lumières les connaissances enseignées par l’Education nationale et pas au-delà, une série de références et d’arguments.
Comment ce type, que j’avais cru sincère et trouvé intéressant, pouvait-il faire confiance à une hystérique pareille ? J’ai conservé la plupart des courriers ahurissants qu’elle m’envoya pour contrer mes positions pourtant argumentées et sourcées, et dans lesquels elle me montrait l’étendue de son ignorance. Quand elle eut épuisé son sac de jugements crétins sur les intentions qu’elle m’attribuait, elle conclut en crachant : « Je vous méprise ».
Restait à comprendre que le monsieur qui se cachait derrière elle pour ne pas répondre à mes assertions, en fait plafonnait très bas : il la croyait intelligente.
Bon, on n’allait pas se fâcher pour autant. Je restai en contact avec lui, et lui envoyai « La Marche rouge » dont il publia une recension en prenant un pseudonyme féminin. On avance, on avance : à partir d’une recension, on peut commencer à discuter, et c’est ce que je cherchais.
Sous la condition que je pourrais le faire sans me faire insulter – il s’y engagea -, je lançai le débat sur Voltaire, le plus facile à démonter de sa caste.
Or, après quelques échanges polis et argumentés avec quelques-uns de ses collaborateurs, le monsieur ne put s’empêcher de lâcher sa hyène :
« Décidément, votre haine de Voltaire vous aveugle. Votre dévotion au catholicisme et à l’Ancien Régime ne lui pardonne pas de nous avoir débarrassés des superstitions, de l’Inquisition et du fanatisme et d’avoir contribué à la Révolution française, avec ses conceptions d’égalité et de liberté, insupportables aux yeux de vos pareils… » me cracha-t-elle, indignée de mon outrecuidance à remettre en cause LE dogme républicain.
Et voilà le travail ! Encore un coup pour rien. Je laissai là le connaud et sa connasse et retournai à mes chères études.
– Ça va venir Marion. Ça va venir. J’en suis sûre.
C’était un jour de découragement, un de ces si nombreux jours de ma vie au cours desquels ma conviction de bien faire se heurtait à la dure réalité dans laquelle je me trouvais. J’avais été maudite, on avait craché sur moi des mots de malheur dont je portais les conséquences dramatiques à la fois sur le plan social et intime.
Écrire, écrire, partager, j’ai ça dans le sang, c’est comme ça que je veux socialement exister, et on m’a coupée des gens susceptibles de me lire et m’entendre.
– Ca va venir Marion. Je le sais.
Des mots comme ça sont une bénédiction. Prononcés par une femme à qui, en son temps, j’ai tendu la main et dont j’ai soutenu le combat, je les ai sentis comme le contraire de la malédiction qui m’avait isolée et coupée des gens avec qui je voulais partager le meilleur de moi-même.
Juillet 2011. « Vous allez trouver Marion. Parce que les gens que vous cherchez cherchent de leur côté. »
Cette autre bénédiction est venue de quelqu’un à qui je n’ai rien donné mais qui m’a croisée et appréciée.
Début août 2011. Ma vie aura été un long combat dont je ne récolterai pas les fruits. Même l’Internet ne peut rien pour moi. Mes textes n’y circulent pas, ils tombent, là aussi, dans les oubliettes. C’est foutu.
Mi-août 2011. Qu’est-ce ce que c’est que ce gars-là ? Alain qui ? Alain Soral ? Soral, comme Agnès ?
Une vidéo. Une autre. Une troisième, et plus, et encore et encore.
« Tout ce qui monte converge » m’a appris Teilhard de Chardin.
Quand on se tire vers le haut, on finit par rencontrer ceux qui font pareil.
Lui ne le savait pas encore, mais moi j’avais compris que j’avais trouvé celui qui allait m’ouvrir la porte qu’« on » s’obstinait, depuis des décennies, à me tenir fermée.
J’en étais sûre comme on ne peut pas plus. Je n’ai pas eu l’ombre d’un doute quand je lui ai écrit, quand je l’ai rencontré, quand je lui ai envoyé mon premier texte.
J’ai vu récemment un documentaire sur les gens heureux. Qu’est-ce qui fait le bonheur ? Il paraît que c’est la capacité à avoir de la gratitude. Les gens malheureux sont les grincheux qui en veulent à la terre entière. Et les gens heureux sont ceux qui, sincèrement, sont reconnaissants de ce qu’on a fait pour eux. Ceux qui pensent, et qui disent « merci ».
Merci, Alain.
Et vous, tous ceux qui me soutenez, m’écrivez et commentez mes textes et vidéos avec tant de sincérité et d’émotion, merci à vous aussi.
Sursum corda ! Haut les cœurs !
Marion
Fin de la série
EPISODE 1
EPISODE 2
EPISODE 3
EPISODE 4
EPISODE 5
EPIDODE 6