Série – Comment Internet a permis de contourner la censure – Épisode 2 : du kibboutz au pilon
Des éditeurs, des correcteurs et de la presse dont, jusqu’à Internet, on ne pouvait se passer pour atteindre ses lecteurs.
Souvent je lis ou j’entends, ici où là, que j’ai rejoint E&R et Alain Soral parce que je désespérais de trouver un éditeur.
C’est une contrevérité.
J’ai trouvé mon premier éditeur en 1989, et je n’ai cessé depuis d’enchaîner contrat sur contrat avec des maisons d’éditions. Citons Sylvie Messinger, Flammarion, Denoël, L’Harmattan, l’Atelier, Jacqueline Chambon, Éditions de Bourgogne et Actes-Sud avant Kontre Kulture, puis enfin Civitas et Sigest depuis.
Me présenter comme ayant eu du mal à me faire éditer c’est vraiment n’avoir rien compris à mon parcours et à la nature de mes difficultés.
Peu de temps après avoir rejoint E&R, j’ai proposé une série d’articles destinés à raconter ce que fut ma longue traversée du désert.
Les revoici.
2e partie : Du kibboutz au pilon.
A l’époque de la sortie du Petit Coco, je travaillais comme secrétaire dans la presse et tentais en vain de passer journaliste. Je m’étais fait embaucher dans ce but, et suivais le cursus interne qui devait le permettre. Mais une barrière infranchissable se dressait toujours entre mon aspiration professionnelle et sa réalisation.
Dans ma boîte, tout le monde savait pourquoi je n’y arrivais pas, et personne ne m’en informa. Ce n’est que des années plus tard que j’appris, de source sûre, la raison de ce nouvel échec : il portait le nom du responsable syndical qui était là, disait-il, pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs[1].
Pas les miens en tout cas. La raison en est simple.
C’est chose commune de dire que le désir engendre d’abord de la peur. Qui ne s’est senti déstabilisé quand a surgi dans son quotidien cet envahissement par l’autre ? Chez les êtres normalement constitués, cette fragilisation se mue en amour.
Chez un pervers, elle se transforme en haine destructrice.
Si je sais que ce salopard se dressa pour m’empêcher de passer journaliste, je n’ai aucun moyen de savoir s’il intervint également pour faire capoter mon premier livre. Je sais seulement qu’il en avait le désir, et le pouvoir.
Sans percevoir à l’époque l’étendue de sa capacité de nuisance, je sus, d’instinct, comprendre comment j’avais pu, avec l’histoire qui était la mienne, tomber dans les griffes d’un tel sadique. Nul n’est tenu de perpétuer son propre malheur : je coupai les ponts et changeai de trottoir.
Puisque la presse m’était fermée, j’allais continuer d’écrire des livres.
Pour publier Le Petit Coco, Sylvie et Jeanne m’avaient convaincue d’en extraire ce qui avait trait à Israël et qui, disaient-elles, pouvait faire l’objet d’un livre en soi.
Rapidement ma fringale d’écriture me reprit et je m’attelai à mettre en forme ce qui avait été l’expérience passionnante et salvatrice de ma rencontre avec le kibboutz, Israël et le judaïsme, puis avec les Palestiniens.
Jeanne adorait. Comme elle avait fait la première fois elle me relut, me conseilla, me poussa de toute sa conviction et de tout son instinct de professionnelle, jusqu’à ce qu’un beau jour je lui apporte 300 nouvelles pages :
– Très bon, dit-elle.
Ce fut elle qui déposa mon texte sur le bureau d’une grosse dame qu’on surnommait à l’époque « la papesse de l’édition parisienne ». Cette dernière l’y laissa pendant des mois sans y toucher, je finis par penser à autre chose. Quand un matin, le téléphone sonna :
– Pouvez-vous venir ce soir signer un contrat ?
Admettons que Sylvie et Jeanne aient pu se tromper sur mon premier livre, la papesse de l’édition parisienne ne pouvait se tromper sur le second. Elle me redit ce qu’on m’avait déjà dit : mon talent, l’intérêt du sujet, le style, le fond, la forme, tout lui convenait, elle venait de trouver une perle et son avis comptait plus que celui d’un autre.
Elle me versa un à-valoir de 40 000 F (une fortune pour moi), et me demanda de travailler à une mise en forme un peu différente de celle que je lui avais proposée. Un éditeur c’est fait pour ça : accoucher un auteur, pour faire d’un bon texte un livre.
Je fis sur les représentants le même effet que j’avais produit dix-huit mois auparavant : on m’applaudit, on vint me féliciter, me tirer le portrait, m’encourager. Ah ! Enfin un sujet, un vrai : du vécu, du sensible, de l’actuel, et bien écrit. Et ceci non plus dans une petite maison d’édition mais dans une grande, une des plus grandes.
Mon tout premier agacement apparut à la réception de mes épreuves corrigées. Après que j’eus revu avec mon éditeur et le fond et la forme, après que nous nous soyons mis d’accord pendant plusieurs semaines de travail acharné, on avait remis mon texte à un correcteur. Et là un vilain doute s’empara de moi …
Dans le passage où je racontais ma découverte de Jérusalem et décrivais « la splendide mosquée d’Omar et son dôme d’or… », le correcteur avait changé cela en « le splendide dôme du Rocher… »
Qu’est-ce que cela signifiait ? Remplacer « mosquée d’Omar » en « dôme du Rocher », ce n’était pas corriger une faute c’était en mettre une, en l’occurrence un pléonasme : le dôme du Rocher et son dôme d’or. Quelqu’un avait remplacé un texte correct par une faute, mais pas n’importe quelle faute : celle de quelqu’un qui connaît les lieux et sait que ce que certains appellent la Mosquée d’Omar est également appelée le Dôme du Rocher.
Quelqu’un aurait-il voulu m’envoyer un signal ? Quelqu’un qui était là non pour corriger des fautes de français, mais autre chose. Quelqu’un qui, à la place d’un correcteur de métier, venait mettre son nez dans mes écrits…
Plus loin, autre chose. Par une formule que je voulais ironique, j’avais écrit « j’avais profané de la Souffrance Juive », qu’on avait transformé en « souffrance juive ». Pourquoi ? Pouvait-on me croire à ce point ignorante de la typographie, qu’on me refuse le bénéfice de la faute volontaire ?
Je demandai qu’on revienne à mon texte initial, j’acceptai un certain nombre de petites modifications, et je renvoyai à l’éditeur.
Les épreuves suivantes devaient revenir avec le bon-à-tirer. Quand l’auteur a signé le bon-à-tirer, ça veut dire « à partir de cette limite, s’il y a des fautes elles m’incombent. »
A la réception de mes exemplaires, je me précipitai pour relire ma prose.
Allons bon !
« Que l’armée de défense d’Israël fût une armée différente et que les soldats juifs furent plus humains que les autres… »
Comment cela « furent » ? Je n’ai pas écrit « furent », mais « fussent », au subjonctif dans les deux propositions. Qu’elle fût et qu’ils fussent. Et non pas qu’elle fût et qu’ils furent. En quel honneur ?
On avait introduit une faute dans mon texte, mais surtout on était intervenu après le bon-à-tirer.
La colère me prit. Qu’est-ce que cela signifiait ?
Je relus tout mon livre, fébrile.
Là, une bourde qui n’y était pas à l’origine. Je conduis une voiture à côté d’un soldat que je n’ai pas vu grandir et vient de me montrer qu’il n’est décidément plus un gosse. Je lui demande son âge. Il me répond et, inquiète, je me jette un coup d’œil dans le rétroviseur avec ce commentaire en moi-même.
Quel coup de vieux !
– Mais oui, tu es belle ! S’exclame-t-il, me montrant ainsi qu’il a compris.
Ce que tout le monde peut comprendre, sauf l’abruti qui a clos le paragraphe à « quel coup de vieux » et ouvre le suivant, qui se situe ailleurs, sur « mais oui tu es belle ».
Je me suis décarcassée à peser chaque mot, à relire tout haut phrase par phrase, à fouiller des dictionnaires pour éviter les redites, j’ai passé des semaines et des mois à parfaire un travail de romain, et un anonyme bouscule tout ça et en change le sens par l’introduction toute simple d’une ligne blanche entre deux phrases.
Autre chose : j’ai repris les paroles de la chanson intitulée « Après nous le déluge », dont le refrain dit « Non, ne me parle pas de cette enfant qui a perdu son œil ». On a changé ça en « cet enfant ». Pourquoi ? Une enfant, ça ne plaît pas à quelqu’un ? De quel droit est-on intervenu, c’est moi qui connais l’original qui dit « yalda », une enfant, et non « yeled », un enfant. Cette main inconnue qui se mêle de mes affaires m’inquiète et me ronge. Qu’est-ce qu’elle veut ? Qui l’a autorisée ?
Plus loin, je bondis. Ah non, là c’est trop fort.
J’y ai écrit deux pages d’un cauchemar éveillé, d’un scénario possible si rien ne change. J’imagine que tous mes amis sont morts, que Gaza est rasée et Jérusalem en flammes, et que, retranchés dans d’anciens camps de réfugiés en Cisjordanie, les fous de Dieu terrorisent la population palestinienne depuis l’assassinat de Yasser Arafat.
Que la main inconnue a changé en « assassinat d’Abu Jihad ».
Quelqu’un est intervenu dans mon texte et a jugé, sans rien m’en dire et après l’envoi du bon-à-tirer, que Yasser Arafat étant encore vivant et Abu Jihad (dont je ne parle nulle part) assassiné, il fallait remplacer l’un par l’autre.
Quelqu’un qui se soucie comme d’une guigne du sens de mon texte, mais qui s’arroge le droit, à qui on a donné le droit, d’en changer le sens.
Il fut bien évidemment inutile d’aller protester. Le livre était imprimé, les exemplaires de presse allaient être envoyés, on verrait ça à la première réimpression. J’avais déjà compris qu’il n’y en aurait jamais.
Quand tous les exemplaires de presse furent signés et partis, il n’y avait plus qu’à attendre, mais un événement grave survint : la guerre du Golfe, rien de moins.
La gosse dame en personne revint en scène pour me dire, par téléphone, que la sortie de mon livre était reportée sine die.
– On craint qu’il soit mal interprété et ne soit perçu comme étant contre Israël, ce qu’il n’est pas, crut-elle bon de spécifier.
« On » n’avait, bien entendu, ni nom ni visage.
« On » dut se calmer quelque peu puisque, quinze jours plus tard et la guerre n’étant pas encore achevée, le livre parut enfin.
– Pouvez-vous venir lundi au journal de treize heures de La Cinq ?
Une télé, enfin, j’étais lancée.
Le flop qui suivit fut à l’image du précédent. Dès que le rendez-vous de la Cinq fut annulé, je compris que le reste suivrait. Aucune radio, aucune télé, pas d’interview dans les quotidiens nationaux. De province parvinrent des coups de fils suivis d’articles élogieux, mais rien de ce qui fait la promotion normale d’un livre normal ne se passait, alors que l’actualité était avec moi : en 1991 en pleine guerre du Golfe, les Palestiniens dansaient sur les toits au passage des Scud, si quelqu’un avait quelque chose à dire à ce propos…
Un jour pourtant l’attachée de presse m’annonça une recension de mon livre sur France Culture, à l’occasion d’une émission qui traitait ce jour-là de livres sur Israël. Je branchai le magnétophone.
« Finalement, dit en substance un de ces éminents spécialistes de la question, il y a dans l’Intifada quelque chose de l’ordre de la reconnaissance d’Israël. Je te combats parce que tu existes. »
Oui, oui, approuvèrent les autres spécialistes, la révolte des pierres, c’est en quelque sorte la reconnaissance d’Israël par les Palestiniens.
Aucun intellectuel de la chaîne pour demander si, dans le même ordre d’idée, la Résistance c’est la reconnaissance du nazisme, la révolte de Soweto celle de l’Apartheid ou la révolution de Budapest celle du stalinisme.
Pour ce qui concerne mon livre, ce fut bref : on le balaya d’une phrase après m’avoir traitée de naïve d’avoir cru à mes fantasmes de jeunesse, et on passa à autre chose.
Quelque temps plus tard sortit un film sur lequel je pouvais rebondir. « Pour Sacha », d’Alexandre Arcady, racontait l’histoire d’une jeune femme de vingt ans partie vivre au kibboutz avec l’homme qu’elle aimait.
Tout y était, tout : l’ambiance, la beauté des paysages, l’intérieur si caractéristique des maisons kibboutziques, les fêtes et les interrogations. « Pour Sacha » était un beau film qui, sous couvert d’une histoire d’amour, mettait en scène des jeunes sionistes confrontés à la guerre et également à la réalité palestinienne. Je rendis visite à mon attachée de presse.
Elle n’éprouva même pas le besoin de réprimer sa moue de mépris. Quoi, intervenir dans les médias en même temps qu’un cinéaste aussi connu, mais pour qui me prenais-je, pauvre conne ?
Dans le même temps commença à tomber sur mon répondeur, la longue, très longue liste des invitations à venir donner des conférences pour les associations informées par le réseau militant. On me réclama dans toute la France, en Suisse et jusqu’en Allemagne, pour venir témoigner en personne de la réalité que je connaissais. Gratuitement évidemment, les braves gens qui se déplacent pour entendre des vérités lointaines ne sont pas les riches. On me remboursait mes frais et on m’hébergeait, je n’en voulais pas plus.
Le rendez-vous du 1er avril 1991 sur France Inter, bien que prévu de longue date, ne fut pas annulé. Je m’y retrouvai en compagnie de deux Israéliens partisans de l’autonomie palestinienne dans les Territoires, ce qui était à l’époque le point de vue du parti travailliste israélien.
Je leur dis mon désaccord et affirmai que les Palestiniens ne devraient pas plus jouir d’une autonomie sous contrôle israélien que le contraire.
Ce que j’ai dit au cours de cette rencontre, c’est ce que j’ai écrit dans le livre qui venait de paraître, à savoir que je ne voyais dans cette région du monde de solution autre que démocratique sur la base d’une complète égalité des droits pour tout le monde.
Crime impardonnable, je pense. Car quelques jours plus tard, je me fis jeter du bureau de la grosse dame.
– Dehors ! me dit-elle tout simplement. Sortez de mon bureau, je ne veux plus jamais vous voir !
– Qu’est-ce que j’ai fait pour que vous me traitiez comme ça ?
– Sur France Inter, vous avez été odieuse…
Elle m’avoua tout de même ne m’avoir pas entendue elle-même, mais après ce que « on » lui en avait dit, elle avait décidé de me rayer de son carnet d’adresse.
– Vous deviez être émotive, vous avez été passionnelle.
J’avoue ne pas connaître la règle de ce jeu-là, m’étant contentée de dire sur les ondes ce que j’avais écrit et qui justifiait qu’on m’y invite.
Avant de sortir de son bureau, je me souviens de lui avoir dit, les larmes aux yeux, que c’était ma vie qu’elle brisait. Ma vie, celle de mon engagement, de mon amour pour ces deux peuples que j’avais décrits avec toute la sincérité et l’authenticité dont j’étais capable.
Elle haussa les épaules en crachant un « pff… » de dédain.
Quand, un an plus tard, arriva mon premier relevé de droits d’auteur, je constatai que 1 700 exemplaires de mon ouvrage avaient été pilonnés. Contractuellement, ils avaient bien sûr le droit de ne pas conserver d’invendus. Mais ils en avaient écoulé 1500, le livre s’était vendu. D’autre part, il était bien écrit en toutes lettres qu’avant une mise au pilon, l’éditeur proposait à l’auteur de reprendre ses exemplaires au prix de fabrication.
On respecte sans doute sa signature ailleurs ou avec d’autres. Avec moi, la maison se contenta de se renier, libre à moi de leur intenter un procès.
Avec quoi ?
Après pilonnage, il leur restait quelques centaines d’exemplaires qu’ils pilonnèrent bientôt de la même manière. Il n’y a plus trace de Marion Sigaut dans la maison.
(A suivre…)
Voir mon précédent article « France, mère des arts ».
Écouter l’interview sur France Inter
Le livre pilonné est désormais disponible chez Kontre Kulture :


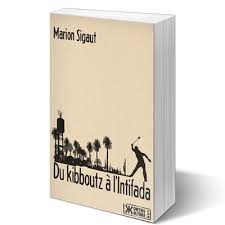


Docteur Louis Mélennec.
Incroyable ! Personne n’a osé écrire le moindre commentaire !
A moins qu’il n’ait eu que des injures, procédé débile, seule arme dérisoire des débiles.
Votre texte est magnifique : vous êtes une vraie et magnifique écrivaine.
Oui : il n’y a en Palestine qu’une seule solution – s’il y en a une : l’égalité des deux peuples qui l’habitent.
Le seul fait que personne n’ait eu le courage de consigner sous votre texte le moindre commentaire, me fait l’obligation d’en composer un. Rien ne m’est plus odieux que la couardise.
Merci au bon docteur.