Série – Comment Internet a permis de contourner la censure – Épisode 5 : Personne ne veut d’un sujet pareil
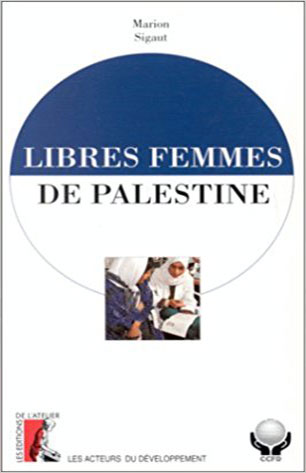 Des éditeurs, des correcteurs et de la presse dont, jusqu’à Internet, on ne pouvait se passer pour atteindre ses lecteurs.
Des éditeurs, des correcteurs et de la presse dont, jusqu’à Internet, on ne pouvait se passer pour atteindre ses lecteurs.
Souvent je lis ou j’entends, ici où là, que j’ai rejoint E&R et Alain Soral parce que je désespérais de trouver un éditeur.
C’est une contrevérité.
J’ai trouvé mon premier éditeur en 1989, et je n’ai cessé depuis d’enchaîner contrat sur contrat avec des maisons d’éditions. Citons Sylvie Messinger, Flammarion, Denoël, L’Harmattan, l’Atelier, Jacqueline Chambon, Éditions de Bourgogne et Actes-Sud avant Kontre Kulture, puis enfin Civitas et Sigest depuis.
Me présenter comme ayant eu du mal à me faire éditer c’est vraiment n’avoir rien compris à mon parcours et à la nature de mes difficultés.
Peu de temps après avoir rejoint E&R, j’ai proposé une série d’articles destinés à raconter ce que fut ma longue traversée du désert.
Les revoici.
5e partie : Personne ne veut d’un sujet pareil.
Lors de mes premières publications, j’émargeais chez les trotskistes.
Ce que je faisais là en étonnait plus d’un dans mon entourage, essentiellement parmi ceux qui savaient que je n’avais rien d’une marxiste. Mais ainsi va la vie, faite de bouts de chemin qu’on fait avec ceux-ci puis avec ceux-là, au gré des rencontres et des situations. Déçue par les socialistes, j’avais été serrée de près par quelques militants qui avaient apprécié mon sens de la formule et mon dévouement à mon syndicat, et s’appliquaient à recruter comme d’autres convertissent ou évangélisent. Incapable de faire mon trou où que ce soit, je m’étais laissée convaincre de les rejoindre.
Après tout, pourquoi pas ?
A la sortie du « Petit Coco », leur silence me déçut un peu mais ne me surprit guère. Ce livre, n’était certainement pas un livre politique. Mais qui a dit que les trotskistes ne s’intéressent qu’à la politique ? On trouve dans leurs librairies des ouvrages de tous genres, il me semblait que le mien pouvait trouver sa place.
Il ne le trouva pas, et je n’en fis pas un drame.
Par contre, quand arriva mon livre sur le kibboutz et l’Intifada, ce fut moins clair. Car quoi, le parti défendait bien, ou à tout le moins il le prétendait, la cause palestinienne et ce sans aucune arrière-pensée antisémite. C’eût été le comble, compte tenu du nombre de juifs qui le dirigeaient. Je me croyais donc en territoire allié, et fus bien déçue de la pusillanimité avec laquelle ils traitèrent mon travail.
J’allai alors voir le grand chef en personne et il trancha : ton livre est très bon, il faut en faire une recension dans le journal du parti.
Ça prit plus d’un mois, je finis par m’agacer. J’entrepris d’aller voir celui qu’on avait chargé du pensum, qui m’avoua qu’à chaque fois qu’il se mettait à sa table pour écrire, la plume lui tombait des mains, il n’y arrivait pas. Il avait lu et relu le livre plusieurs fois mais ça ne venait pas.
– Tu comprends, dit-il, d’habitude je ne traite que de livres politiques.
Pas politique, mon livre ? Ce serait donc l’aspect purement personnel de l’histoire qui m’aurait attiré les foudres de ceux qui impressionnèrent la fameuse grosse dame ?
A d’autres.
Mais il n’était pas le seul à penser ainsi puisque plusieurs camarades vinrent me dire qu’il était dommage que je n’aie pas fait un livre politique.
Ils voulaient dire un livre chiant, j’imagine.
Enfin le grand chef trouva quelqu’un d’autre, et un article parut.
Allais-je au moins être lue par mes camarades ?
Ils mirent un petit paquet de cinq exemplaires dans un coin de la grande table de la librairie, et quand il n’y en eut plus ils n’en recommandèrent pas.
Dans l’intervalle, j’avais pris sous ma coupe une vingtaine de réfugiés et leur consacrais mes journées, mes week-ends et parfois même mes nuits. Je tenais, bien sûr, le parti au courant de mes démarches, je leur écrivais de longs comptes rendus circonstanciés du malheur que je voyais se dessiner sous mes yeux. Ils disaient « oui, oui » et passaient à autre chose. C’était comme si je parlais à un mur.
J’eus droit à quelques réflexions désagréables : « on n’a quand même pas que ça à foutre » quand je demandai l’aide d’un russophone capable de m’aider à présenter un témoignage sans avoir à passer par l’hébreu, insuffisant pour mes protégés comme pour moi.
Des russophones, il y en avait dans le parti, et je finis d’ailleurs par en trouver un. « Une » plus exactement, qui réagit en femme et non en militante : ce que je racontais la révoltait, elle m’apporta sa contribution à titre tout à fait personnel.
Pour les autres, rien. Je leur apportais, sur un plateau, des données vivantes et explosives sur une réalité qu’ils auraient dû relayer. La seule réaction que je fus en mesure de déceler de leur part, c’est la gêne.
Elle est bien gentille Marion, mais elle nous emmerde.
Et puis un jour, la peur me prit. La peur du vide, la peur insensée d’une solitude que je trouvais inadmissible. Je ne comprenais pas que je sois seule à me battre pour venir en aide à des juifs qui avaient perdu jusqu’à leur valise pour avoir été rétifs au rêve sioniste. La plupart des dirigeants du parti étaient juifs, certains avaient vécu la guerre, tous avaient perdu de la famille pendant l’horreur, pourquoi diable ne venaient-ils pas m’aider ? Ce ne pouvait être parce qu’ils défendaient l’Etat d’Israël, ils se disaient contre.
La peur, c’est le bout du bout de la solitude. Alors j’y fis face, seule.
Un jour, ma voisine vint me prévenir que des gens étaient venus se renseigner sur moi dans la cour de mon immeuble. S’ils étaient venus, c’est qu’ils savaient où j’étais. Et s’ils se renseignaient, c’était pour me le faire savoir. Pour me faire peur.
Alors c’était réussi, j’avais peur.
Et après ? On peut vivre avec la peur, c’est ce que j’ai appris à faire. Mais j’ai pris le taureau par les cornes, et je me suis rendue chez les flics pour y signaler le fait sur la main-courante. Ca prit un petit moment, ils ne voulaient rien savoir et refusaient de prendre ma déposition, mais ils finirent par accepter.
De retour chez moi, j’appelai la commission Droits de l’homme du parti.
– Attends, ne quitte pas, me dit le responsable.
Au bout de quelques longues minutes, la sonnerie « occupé » m’avertit qu’il avait raccroché.
Alors je décidai d’y aller.
Dans la cour du local, tout ce que l’organisation compte de cadres et de militants s’affairait pour la prise hebdomadaire du journal. J’avisai un membre de la commission idoine et entrepris de lui expliquer. Il était au courant de mon action, de mes démarches, de mes écrits, de mes voyages, de mon engagement, des risques que j’avais pris et prenais encore, il savait de quoi je parlais. Ce que je venais lui apprendre, c’était que « on » venait à présent m’intimider à domicile. Il m’écouta poliment, me fit un large sourire, me passa paternellement la main sur l’épaule et me susurra :
– Fais gaffe à toi tout de même.
Et il tourna les talons.
Dans la cour, j’avisai le responsable de la commission internationale. Il me fit un grand sourire et m’écouta commencer une phrase. Commencer seulement, car quand je l’eus terminée, il était déjà parti. C’était la première fois qu’on me faisait ça, ça fait un drôle d’effet.
– Mais enfin je suis en train de parler ! lui dis-je en le rattrapant et en lui barrant la route.
Courageux, il bredouilla « réunion importante » et disparut.
Alors que, militante sérieuse et dévouée je faisais mon content de distribution de tracts et de vente de journaux, je me permis de refuser un jour de sacrifier un week-end d’écriture au bénéfice de la campagne contre le traité de Maastricht. Et je m’entendis hurler, je dis bien hurler, que l’écriture c’était bien joli mais que quand le traité de Maastricht serait voté, il n’y aurait plus ni écrivains ni maisons d’édition. Aussi, pour l’amour des livres, il fallait que, toutes affaires cessantes, j’abandonne l’écriture du mien pour des activités enfin sérieuses.
Que je cesse de les emmerder avec mes larmes et mon dévouement, pour devenir enfin une trotskiste sérieuse, sans état d’âme, sans sensibilité, sans personnalité, sans cœur.
Quand le livre sortit enfin, je n’étais plus au parti.
La suite est inattendue.
C’est dans le village palestinien d’Umm-el-Fahem que j’entendis pour la première fois parler de l’association qui allait, enfin, me mettre le pied à l’étrier.
– Comment ? Tu ne connais pas le CCFD ?
L’association catholique contre la faim et pour le développement soutenait depuis des années nombres d’Organisations-non-gouvernementales dévouées au bien-être des opprimés, et ses pas l’avaient naturellement conduite dans les villages palestiniens. De retour à Paris, je pris contact avec un certain Claude.
Il est des jours où tout semble vouloir se mettre en place. Traitée comme un chien par mes « camarades » trotskistes, j’allais être considérée et respectée par des catholiques à qui je ne fis jamais mystère de mes positions.
Je fis connaissance avec Claude, nous échangeâmes nos impressions sur tant de gens que nous connaissions sans nous connaître, et je lui dis que je cherchais à écrire des livres.
Il me suggéra d’en parler à sa direction à qui j’écrivis. Ma lettre arriva juste au moment où ils discutaient de cette idée avec les Editions de l’Atelier : pour informer leurs donateurs de l’utilisation des fonds qu’ils levaient, ils voulaient ouvrir une collection intitulée « Les acteurs du développement » qui fournirait des récits courts et vivants sur les projets qu’ils défendaient.
Ce fut la première fois que je travaillai dans des conditions humaines, décentes, valorisantes. Envoyée sur le terrain de Cisjordanie et de Gaza pour y rencontrer une ONG médicale, j’en étais revenue avec un texte si plein d’admiration et de reconnaissance pour les Palestiniennes, que mon éditeur fit le choix de laisser tomber la référence aux réseaux de santé pour me proposer le beau titre de « Libres femmes de Palestine ».
– Quand on donne un savoir à un homme, il pose une plaque et demande qu’on le paye. Quand on donne le même savoir à une femme, elle court le partager avec tout le monde.
C’est en faisant ce constat, valable rigoureusement partout, que des médecins palestiniens partis au secours des populations les plus misérables, firent le choix de former aux soins primaires les femmes les plus pauvres pour entreprendre, avec elles, de tirer vers le haut le niveau sanitaire dramatiquement bas des Territoires.
Ah les merveilles de femmes que j’ai rencontrées ! Spoliées, volées, harcelées, exploitées, misérables, elles me laisseront à jamais le souvenir de leur gentillesse, de leur courage, de leur rage de s’accomplir et de défendre leur terre, leurs proches et leur bonheur. Toujours je garderai le souvenir de nos fous-rires, de notre complicité et de nos émotions partagées. Expérience inoubliable d’une richesse inouïe, mes copines de Palestine m’ont fait quitter, à jamais, les stéréotypes crétins et réducteurs concernant la « libération » des femmes.
Ma collaboration avec les éditions de l’Atelier fut pour moi l’occasion d’apprendre deux choses. La première concerne les personnes dont la tâche consiste à établir des liens entre un auteur et les médias à l’occasion de la sortie d’un livre, j’ai nommé les attachées de presse. C’est là, avec l’Atelier et son coéditeur le CCFD, que j’ai pu constater que la crétinerie pathologique de celles que j’avais rencontrées auparavant n’était nullement inhérente à leur fonction, mais un défaut personnel.
La deuxième concerne mon public : lui aussi existe. Par le biais d’une très longue tournée à travers toute la France auprès des comités locaux du CCFD, mais aussi auprès d’associations de solidarité avec les Palestiniens, ce sont des milliers de Français que j’ai rencontrés.
Et j’en ai tiré une conclusion : elle est belle la France, quand on sait l’écouter, la regarder et s’adresser à elle. Ils sont beaux ces gens de la France profonde, dévoués et généreux, attentifs, désireux d’aider leur prochain, d’exprimer leur solidarité en actes.
Ils sont beaux les Français de l’intérieur, l’intérieur du cœur et du courage. Et on est fier d’en être. C’est pour eux que j’écris, c’est à eux que je m’adresse.
Le CCFD m’ayant demandé de participer à l’élaboration d’un film de dix minutes sur les libres femmes de Palestine, je décidai de chercher un producteur pour faire quelque chose des huit heures de rush inutilisé.
L’idée était de mettre en exergue l’un des plus beaux chapitres du livre, celui qui montrait comment une poignée de femmes pauvres révolutionnait tout un village en apportant un regard nouveau sur les handicapés. Handicapés du bout de la misère, femmes opprimées autant par leur environnement immédiat que par l’occupation : le chapitre intitulé « Réhabilitation » méritait un film à lui tout seul. Les lecteurs avaient tellement été touchés par le personnage de Majda qu’une lectrice, Elisabeth, lui avait même dédié une chanson.
Je rencontrai assez facilement un producteur qui me mit à l’aise : il n’était pas sioniste, même si son patronyme avait pu me le laisser craindre. Il avait aimé mon livre, vu tous mes rushes, apprécié mon script, il était d’accord avec mon projet qu’il jugeait bon. J’allais faire un film.
Pour aller à la rencontre de chaînes de télévision, il lui fallait un scénario, je n’en avais jamais fait : il me montra. Je lui donnai un premier jet, il m’expliqua comment le perfectionner, et enfin un jour, il me dit que c’était bon. Pouvais-je lui rédiger un argumentaire ?
Oh que oui ! Expliquer que ce que je voulais montrer, c’était l’aspect positif des choses. Qu’on puisse voir non des femmes dolentes et geignardes, mais actives et marrantes, ouvertes sur le monde, décidées à faire quelque chose pour sortir de leur misère. Non des musulmanes soumises, mais des Orientales généreuses à qui on ne la fait pas. Je voulais montrer que le résultat de leur détermination, loin d’être la haine de leurs hommes, c’était au contraire la reconnaissance officielle, dans leur village dirigé par des islamistes, quelles étaient l’exemple à suivre.
De quoi balayer tous les clichés.
Alors qu’il m’avait fait venir à Paris plusieurs fois, c’est au téléphone que le producteur me soumit les conditions qu’une chaîne de télévision lui avait posées. Pouvais-je revoir mon scénario en changeant quelques petites choses ?
Oui bien sûr.
Vous notez ? J’énonce.
Il faudrait montrer :
– Que le travail des femmes palestiniennes est piloté par l’aide extérieure ;
– L’oppression que leur font subir leurs maris ;
– Leur impossibilité d’échapper à l’emprise des islamistes.
En un mot comme en mille, pour qu’on produise mon film, est-ce que j’acceptais de dire exactement le contraire de ce qui me motivait pour le faire ?
Et pour conclure, obligé de rompre le silence que ma suffocation lui imposait au bout du fil, il trancha :
– Vous comprenez, la difficulté c’est que vous traitez d’un sujet-repoussoir : les handicapés. Personne ne veut d’un sujet pareil, ce n’est pas vendeur, les gens ne le regarderont pas.
La semaine suivante, le festival de Cannes, debout et en larmes, faisait une ovation à un jeune trisomique qui explosait de joie de vivre et d’humanité dans « Le Huitième Jour ». Mais le monsieur ne me prit pas au téléphone. Car il savait, et il savait que je savais, que ce n’était pas le problème.
« Libres femmes de Palestine » s’était vendu strictement dans le cadre de l’association, la presse ne l’avait pas relayé.
« On » ne m’avait pas lâchée.
(à suivre)



Étonnant.